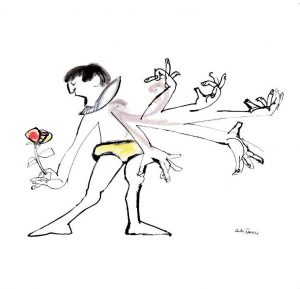
Tous en scène!
André François
Tous en scène !
Extraits du catalogue
Le spectacle sous toutes ses formes a été pour André François une source vive d’inspiration qui a inondé généreusement ses créations graphiques et plastiques. On connaît bien son amour du cinéma et son addiction au monde circassien, mais on sait un peu moins qu’il a aussi beaucoup aimé travailler pour le théâtre et la danse où il a collaboré avec quelques-uns des plus grands dramaturges et chorégraphes du XXème siècle en France et en Grande Bretagne. Sa contribution aux Arts de la scène est d’une qualité inégalable et lorsque, en 1996, le Septième festival de Chaumont leur consacre une exposition thématique, il est légitimement mandaté pour imaginer l’affiche. De lui, qui fut si féru de mythologie, on peut dire que Polymnie (pantomime), Thalie (comédie), Melpomène (tragédie) et Terpsichore (danse), Muses des amphithéâtres de pierre antiques, lui ont été propices.
Lorsque Alain Gauthier, emporté ce printemps par le coronavirus rend, en 2005, un « tendre hommage à André François » pour le « posthume sur mesure » que je lui avais amicalement taillé, c’est cet aspect de l’œuvre de son aîné qu’il privilégie. En effet, il le représente sur une scène aux lourdes tentures pourpres, jouant, au clair de lune, de son pinceau-archet sur une palette-violoncelle : une correspondance baudelairienne d’une rare poésie…
Le sujet est à la mode : la Morgan Pierpont Library de New York a présenté, du 14 juin au 6 octobre 2019, une exceptionnelle « exhibition », Drawing the Curtain : Maurice Sendak’s Designs for Opera and Ballet. Or Maurice Sendak et André François s’étaient rencontrés aux États-Unis et se vouaient une admiration réciproque. C’est de bon augure pour notre exposition du Centre André François, certes infiniment plus modeste que celle de la Morgan, mais non moins inspirée.
Mon titre est un hommage à la comédie musicale de Vincente Minelli (1954) où dansaient, avec tant d’élégance et de brio, les regrettés Fred Astaire et Cyd Charisse.
Avec Polymnie, la Commedia dell’Arte
Les facéties de Polichinelle…
Grâce à sa très british épouse, André François découvre, dès le début des années cinquante, la presse anglo-saxonne. Il dessine pour l’antique Observer et il collabore à Lilliput où il fait la connaissance de John Symonds qu’il trouve « lunaire » et dont il illustrera les livres, et de Ronald Searle qui sera son ami jusqu’à sa mort. Il y fréquente aussi des photographes, Brassaï, Ylla, aventurière et animalière, et Robert Doisneau qui, inévitablement, lui tirera le portrait. C’est par le vénérable Punch, créé en 1841, qu’André François se lie à Quentin Blake. Pour ces revues d’importance historique, André François, séduit par ce qu’il appelle leur « excentricité », ne se contente plus de fournir des petits dessins amusants. Il crée quelques couvertures inoubliables qui contribuent à asseoir sa réputation.
Or, le magazine satirique et humoristique Punch, qui parut de 1841 à 2002, déclinait presque systématiquement, à la une, l’image de sa mascotte au nez en bec de corbin et au menton en galoche, Punchinello, frère britannique de notre Polichinelle et du Pulcinella napolitain. André François s’y révéla virtuose, intégrant adroitement Punch dans les positions les plus inattendues comme sur la panse d’un vase de fleurs en faënce bleue (9 février 1966), ou sur le nœud de cravate d’un homme d’affaires aux extraordinaires lunettes pour qui Time is money : cette couverture du 29 juin 1966 fut offerte au Centre André François par David McKee, autre grand collaborateur du magazine. L’original de cette couv, auréolé de dentelle noire calcinée, fut retrouvé dans les décombres après l’incendie de son atelier.
Hommages à Paris, Punchinello fait mijoter, sur un antique fourneau, de la cuisine française au fumet tricolore en forme de Tour Eiffel (2 octobre 1963), alors que sa tête, toute petite, émerge d’un soupirail des bords de Seine (8 août 1962).
Monstreusement vert, son profil s’étale sur toute la page du 2 janvier 1963, avec, comme un hublot percé dans ce faciès violent, le reflet d’un visage féminin dans son œil écarquillé : cette image intrigante a une forte parenté avec celle de la couverture de The Inside Story du psychiâtre Fritz Redlich en 1960 (New York, Vintage Books). Un autre profil, plus agressif encore avec ses dents menaçantes, se compose de collages de morceaux de journaux anglais déchirés (26 février 1964).
André François a toujours aimé le courrier venu de contrées imaginaires, les enveloppes fantaisistes, les oblitérations festives. Il en a fait le sujet de plusieurs couvertures du New Yorker, et de deux célèbres albums pour enfants Lettre des îles Baladar (1952) et Les Larmes de crocodile (1956). Il allait de soi qu’il créerait un timbre à l’effigie de Punch, oblitéré au chimérique pays de Punchitania (10 juin 1964).
Punchinello est promené au milieu des neiges, douillettement emmitouflé dans un traîneau (23 novembre 1955) ; changé en marionnette, il assomme de son gourdin une poupée verte outrageusement maquillée (28 mars 1962) ; il est déguisé en caméléon (17 avril 1957), en pic-vert (25 mars 1959), en chef indien (1er octobre 1958), en groom squattant un ascenseur au mépris des nombreux usagers qui l’attendent (11 novembre 1959), en chevalier médiéval à l’armure emplumée (12 mars 1958). Moderne Lohengrin, il chevauche un cygne sur l’enseigne d’une taverne (14 août 1963). Il est assommé par la chute d’une lettre de son nom au coin d’une rue (13 mars 1963). Il se cache dans un groupe de sévères bourgmestres flamands (28 août 1957). Jockey, il se fait raccommoder la casaque par une robuste couturière (15 juin 1960). Son bonnet rayé à pompon se mêle à la foule de messieurs très anglais avec leurs sombres chapeaux-melon (14 novembre 1962). Son nez busqué sert poétiquement de baisodrome à deux printanières coccinelles (19 avril 1960) et un masque clownesque cache le visage de l’épouse dans une célèbre et cruelle scène matinale de breakfast conjugal (3 février 1960).
Commediante ! Tragediante !
Séléné aura désormais, dans ses dessins, le profil de Polichinelle (Punch, 10 mars 1948 et 10 juin 1959) et on la retrouvera aussi à la une du Graphis N°44, ce qui ne manquera pas d’influencer des artistes aussi différents qu’Elzbieta ou Étienne Delessert.
La forte identité graphique du magazine, résolument satirique, éloigne André François, mais aussi Quentin Blake, Ralph Steadman, Ronald Searle, David McKee ou même Sempé et Folon, autres contributeurs de la revue, d’une tradition picturale héritée de Giovanni Domenico Tiepolo dont les sublimes peintures ont fortement influencé les décors et costumes créés par Maurice Sendak pour L’Amour des Trois oranges : cette œuvre plus italienne que russe de Sergueï Prokofief, inspirée par le vénitien Carlo Gozzi, fut donnée à l’Opéra de Glyndebourne le 25 mai 1982. Le grotesque Punch d’André François, farceur et turbulent, vivement coloré, ne ressemble guère à celui de Sendak ni aux élégants tableaux et fresques de la Ca Rezzonico de la sérénissime, même s’il découle des mêmes sources.
Encore et toujours hérité des scènes comiques de la Commedia dell’Arte, l’astre lunaire ainsi grimé et un soleil rondouillard seront les deux adversaires d’une joute picrocholine insolite, inspirée par une gravure de Dürer qu’André François admirait (You are Ri-di-cu-lous Pantheon Books, New York et Toronto). L’école des loisirs, dont André François venait tout juste de créer l’affiche et le célèbre logo du papillon-lecteur, l’éditera deux fois, en 1971 (Qui est le plus marrant?) et, quelque peu modifié, avec un autre titre calqué sur le titre américain, en 2011 (Ri-di-cu-le). Il paraîtra aussi en Allemagne (Wir sind zum Lachen Fabbri & Preger, Munich, 1973) et deux fois en Italie (Chi è il più buffo ? Babalibri 1970 et 2011).
Paris Match édite en 1961 un étonnant plaidoyer pro domo, Le Président Directeur Général, fastueux leporello publicitaire de près de cinq mètres de long, relié sous toile, graphiquement jubilatoire, qui fut un choc pour les jeunes illustrateurs de ce temps : Daniel Maja se souvient de sa découverte émerveillée alors qu’il était élève de l’École Estienne. Parmi les personnages truculents mis en scène sur cette rareté bibliophilique, on retrouve notre Polichinelle. Le galeriste Michel Lagarde a le projet de rééditer ce petit chef d’œuvre.
… et les couleurs d’Arlequin…
Qu’un peintre soit séduit par le multicolore Arlequin n’est guère surprenant. Sous la direction artistique de Michel de Brunhoff, frère de Jean, le papa de Babar, « d’une gentillesse et d’une politesse à vous donner des ailes », disait-il, André François l’a représenté, en février 1950, sur une couverture du luxueux magazine Vogue, où son costume est un élégant patchwork de tissus raffinés : l’intérieur de la revue publie un article, espièglement intitulé « Les Trames nommées Désir », sur les étoffes de la Haute couture. Ce clin d’œil à Tennessee Williams et Elia Kazan est-il d’André ? Il serait bien dans sa manière !
On retrouvera Arlecchino, facétieux à souhait, sur une joyeuse pochette de disques en 1958 (25 ans de succès, Synergie).
Sur la superbe couverture de la première monographie consacrée à André François, The Biting Eye, Arlequin trône encore, masqué, buvant goulûment une fiole de couleurs qui vient teindre les losanges de son casaquin (Perpetua Books,1960). Son cher ami Ronald Searle, lui aussi immense dessinateur, a préfacé cet ouvrage et conservait le magnifique original de cette couverture. Quelque temps après son décès survenu le 30 décembre 2011, Pierre et Judy Farkas, fils et bru d’André François, furent heureux de l’acquérir dans une galerie de la capitale britannique.
Novum Gebrauchsgrafik (1982) dévoile une variante de l’image précédente : Arlequin colore sa casaque en s’abreuvant de peinture, mais sirotée avec une grande pipette plongée dans un tonneau.
On trouve aussi d’autres versions du thème de la colorisation dans Punch : Polichinelle prend un bain de teinture dans une prosaïque baignoire (9 août 1961), et, sur la couverture du 7 août 1957, on voit, surplombant la skyline londonienne, un funambule biberonneur de peinture, toujours habillé en Arlequin, mais affublé du tarin crochu de Punchinello : un malicieux syncrétisme.
Humour, jubilation et poésie…
Avec Thalie et Melpomène, le théâtre
On peut être surpris que, parmi la belle cinquantaine de couvertures du New Yorker qu’a dessinées André François, aucune ne soit inspirée par le monde de la scène, sauf, peut-être, celle du 18 février 1967 qui figure un vestiaire avec ses manteaux et pardessus suspendus sous une étagère où s’amoncellent des borsalinos numérotés. Est-il hasardeux d’imaginer qu’il s’agit du dressing room, non d’un quelconque restaurant, mais plutôt d’un opéra ou d’un théâtre ? Une petite allusion aux beaux soirs de la Grosse Pomme si chère à son cœur ? L’hypothèse est séduisante…
Alfred Jarry…
Sa contribution la plus célèbre au monde du théâtre n’est pas destinée à la scène. C’est l’illustration du texte de Ubu Roi ou les Polonais, drame en cinq actes, le chef d’œuvre iconoclaste d’Alfred Jarry (Le Club du Meilleur livre, 1957), avec ses vingt dessins à la plume, savoureusement grotesques et son affiche provocatrice. Son inventivité graphique est en parfaite osmose avec les audaces verbales de Jarry. Les portraits en pied du couple royal, ridicule et inquiétant, sont des merveilles du genre. Robert Delpire avait fait fabriquer le gabarit de leur silhouette grandeur nature : le père et la mère Ubu, en loufoque majesté, accueillaient, à Beaubourg, les visiteurs de son exposition L’Épreuve du feu en 2004. Il faut dire aussi que le livre est hautement servi par la maquette inattendue du regretté Massin, disparu cet hiver, et le choix de ce génial graphiste d’alterner deux sortes de papier, le Djebel blanc des Papeteries Prioux pour les images, et un papier « de boucherie » bistre pour le texte. Si les originaux du livre ont disparu dans l’incendie de son atelier, quelques esquisses demeurent dans des collections privées. J’ai pu acquérir une planche de dessins à la plume venant de la collection de Colette Portal : André François fut très lié au couple Portal-Folon.
André François n’est certes pas le seul artiste à s’être confronté à la farce d’Alfred Jarry qui fut lui-même le premier illustrateur de son propre texte. Nombreux sont les peintres, lithographes, graveurs et dessinateurs, plus ou moins célèbres, qui ont imagé cette pièce à jamais actuelle. On doit ainsi à Pierre Alechinsky, René Auberjaunois, Serge Bloch associé lui aussi à Massin, Etienne Delessert, Edmond Heuzé, Jan Lenica, Joan Miró, Ricardo Mosner, Jacob Rozendaal, Wolfgang Schlick, Franciszka Themerson, Daniel Tricard… d’intéressantes, et parfois éblouissantes, variations autour des dangereuses aventures politiques d’Ubu roi, si annonciatrices des désastres du XXème siècle.
Sans compter les lectures de Ubu cocu, Ubu enchaîné, Ubu sur la butte et des Almanachs du Père Ubu, ainsi que les avatars édités par d’autres admirateurs du personnage, dont Ambroise Vollard. Et là aussi, les signatures sont prestigieuses : Georges Rouault, Pierre Bonnard, Max Ernst, Dora Maar, Pablo Picasso, Roberto Matta, Jacques Carelman… Nonobstant, il me semble qu’André François, héritier de l’esprit caustique de sa Mitteleuropa natale, est l’un de ceux qui a osé montrer le plus d’audace et d’insolence dans la vulgarité tragico-burlesque du sujet. Dans un passionnant article du catalogue de l’exposition Ubu, cent ans de règne (1989 – Musée de la Seita, magistralement maquetté par l’incontournable Massin), José Pierre compare Ubu à Staline, et fait l’éloge de l’interprétation de Franciszka Themerson. « C’est une réussite totale, écrit-il, que seul André François, en 1958, parvient à égaler en adoptant un parti fort différent… André François a choisi, en somme, d’évoquer le geste d’un couple de petits bourgeois sans scrupules. Sa suite est d’une cruauté rare, et l’on n’oubliera pas de sitôt sa représentation de la « machine à décerveler » ni de l’art « d’enfoncer un petit bout de bois dans les oreilles… La triade de la Physique, de la Phynance et de la Merdre. »
… Roger Peyrefitte
André avait créé en 1951, pour la collection J’ai lu, la couverture du roman autobiographique de Roger Peyrefitte, Les Ambassades, fortement inspiré par son expérience d’attaché d’ambassade à Athènes, où cet homme cultivé s’amouracha de la Grèce antique. L’auteur sulfureux et controversé des Amitiés particulières, fit de nouveau scandale avec ce roman et surtout sa suite, La Fin des ambassades, car l’épouse du politicien Georges Bidault, Suzanne Borel, première femme à avoir été attachée d’ambassade en 1930, se reconnut, non sans raison, dans le personnage de « Mademoiselle Crapotte ».
J’ai retrouvé récemment, grâce à Michel Lagarde, neuf très belles gouaches préparant les décors et les costumes de la pièce Les Ambassades, adaptée du roman éponyme de Roger Peyrefitte par André-Paul Antoine (1961) au théâtre des Bouffes parisiens. Cinq de ces gouaches furent acquises par le Centre André François et j’en ai conservé quatre. Les tableaux d’André François, suivant précisément les indications des didascalies, représentent différents points de vue sur le bureau de l’ambassadeur, élégant et compassé, avec ses lourdes tentures, son mobilier de style et l’affichage ostentatoire d’un arbre généalogique, et aussi sur l’appartement plus décontracté du héros, Georges de Sarre, dont la fenêtre donne sur l’Acropole « blanche et rose ». La gouaille et l’humour du décorateur trouvent à s’exercer dans les projets de costumes. La perfection picturale de ces gouaches rappelle celle des maquettes peintes de décors de cinéma que réalisait son grand ami Alexandre Trauner. Le N°176 de la revue Paris-Théâtre reproduit intégralement le texte de la pièce ainsi que quelques photos, en noir et blanc, de la première représentation, le 28 janvier 1961 : on peut y reconnaître les décors créés par André François.
Enigme
Un énigmatique dessin rescapé du brasier, avec ses bords bruns et noirs de dentelle brûlée, a été retrouvé dans les ruines de l’atelier de Grisy-les-Plâtres tragiquement incendié dans la nuit du 7 au 8 décembre 2002. On peut admirer, intact, ce très beau croquis car il est reproduit, légendé « Le Comédien à la rose », dans la rubrique « Décors et costumes de théâtre » de la monographie André François, préfacée par François Mathey et coéditée, en 1986, par Herscher, Booth Clibborn Editions et Harry N. Abrams. Aucun renseignement supplémentaire, cependant. Projet de costume ? Affiche ? Y aurait-il quelque cousinage avec Le Chevalier à la rose, l’opéra de Richard Strauss ? Comme les documents le concernant ont disparu, le mystère demeure…
… Eugène Ionesco
Également disparues et reproduites dans cette même monographie, trois gouaches collant, avec un rare talent, aux didascalies, succinctes mais précises, et au texte décousu, complètement louftingue, de Scène à quatre d’Eugène Ionesco : les quatre personnages pittoresques de ce dialogue de fous ont été croqués avec une désinvolture jubilatoire et les détails (« Attention aux pots de fleurs ! ») sont poétiques et farfelus à la fois. Cette petite œuvre en un acte, peu connue, poussant à l’extrême l’absurde des situations et des conversations, fut représentée, au Festival international de Spoletto (Italie) en juin 1959, par des comédiens italiens, mais en français. On peut la lire dans son intégralité dans le N°210 de l’Avant-Scène du 15 décembre 1959 mais André François n’y est pas crédité. On peut subodorer qu’André fut ravi de la dernière réplique de la pièce qui en résume parfaitement la teneur : « Mesdames et Messieurs, je suis parfaitement d’accord avec vous. Ceci est tout à fait idiot. ».
André François ne manquait pas de rappeler qu’Ionesco était, comme lui, originaire de l’actuelle Roumanie : une des raisons de leur connivence et de leur goût commun de la gausserie ? Il est certain que, depuis l’ancien Empire autrichien, la Hongrie et la Roumanie ont déversé, au XXème siècle, sur le monde des arts, des lettres, du cinéma et de la musique, des talents exceptionnels que l’on ne peut citer tous : Brancusi, Cioran, Enesco, Fondane, Ionesco, Istrati, Kertész, Nouveau, Steinberg, Tabori, Trauner, Tzara… et André François.
… Claude Confortès
Lorsqu’on évoque le dramaturge Claude Confortés, on rappelle volontiers qu’il fit ses débuts avec Jean Vilar et Peter Brook, et on s’amuse de sa collaboration jouissive avec Reiser et Wolinski, mais on oublie souvent qu’il a travaillé à diverses reprises avec André François, dans les pièces qu’il a écrites ou dans celles dont il réalisa la mise en scène. Cela nous vaut quelques affiches, exceptionnelles de vitalité et de truculence, qui furent, pour la plupart, exposées par Anne-Claude Lelieur et Raymond Bacollet dans leur grande exposition André François Affiches et graphisme à la Bibliothèque Forney en 2003. Ainsi a-t-il créé l’affiche d’une pièce d’Henri Mitton mise en scène par Confortès, Pas un navire à l’horizon, présenté à La Cour des miracles en 1981, ainsi que celles de pièces écrites et mises en scène par Claude Confortès, comme Les Argileux, représentée en juillet 1984 au cloître de la collégiale de Villeneuve-les-Avignon puis au Palais des glaces en septembre de la même année. L’affiche d’André François est une variation osée des portraits en buste, impudemment parodiques de la Joconde, qu’il affectionnait, avec juste une petite touche décalée de friponnerie érotique. C’est la plasticienne Françoise Fugier qui réalisa les sculptures des décors.
Le Marathon, dont André François dessina une affiche devenue célèbre, est une comédie grinçante de Claude Confortès où les musiques et chansons de Jacques Datin et Alain Goraguer sont omniprésentes et où le jeu des protagonistes, particulièrement physique, flirte davantage avec la turlupinade qu’avec la chorégraphie. Elle fut traduite dans une trentaine de langues et représentée un peu partout sur notre planète. Une version provisoire fut diffusée sur les antennes de France-Culture le 17 février 1972. Les trois personnages, bouffons aux noms provocateurs inspirés irrévérencieusement par ceux de poètes du XIXème siècle (Livarot Ducasse, Nazaire Rimbaud et Jules Nerval !), étaient alors joués par Jacques Higelin, Sami Frey et Claude Confortés. Avant la version définitive jouée à Bordeaux en 1973 et au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers en 1974, elle fut donnée à Bruxelles et Grenoble.
On en comptera plus de 5000 représentations dans le monde.
Le texte de cette farce tragi-comique fut édité par la NRF, avec une préface de Peter Brook, dans la collection « Le Manteau d’Arlequin » dirigée, depuis 1958, par le romancier et critique dramatique Jacques Lemarchand dont André François avait illustré, en 1947, le superbe Odyssée d’Ulysse dédié à ses deux enfants, Pierre et Katherine. Le livret est orné de petites images gravées d’André François, certes, mais aussi d’Andrevon, de Cabu, Folon, Gébé, Nicolas, Outin, Pichard, Reiser, Sempé, Secunda, Siné, Topor, Willem et Wolinski : un prodigieux panthéon du dessin d’humour, aujourd’hui décimé par la camarde. Grimaçantes et souvent mortifères, les estampes originales d’où sont issues ces illustrations ont pour la plupart été exposées à Paris du 15 janvier au 9 février 1974, à la Fnac-Sébastopol et à la Galerie Marquet, au 7 de la rue Bonaparte, avec une flamboyante affiche de Jean-Michel Folon.
… William Shakespeare et George Tabori
On sait aussi que cet anglophile impénitent a travaillé avec l’enthousiaste et visionnaire Peter Hall (1930-2017), fondateur de la Royal Shakespeare Company (et alors accessoirement époux de Leslie Caron), sur The Merry Wives of Windsor de Shakespeare à l’Aldwych Theatre de Londres en 1964. Quatre planches à la gouache, avec des projets de costumes d’une impertinente vigueur graphique, portés par des silhouettes cocasses, comme gribouillées à la hâte, sont reproduites dans la précieuse monographie de Herscher déjà citée. Lors de la reprise, en 1968, de cette pièce au Royal Shakespeare Theatre à Stratford-upon-Avon, le nom d’André François est remplacé, au programme, par celui de Timothy O’Brien.
Toujours avec l’incontournable Peter Hall, André François avait créé, pour ce même Aldwych théâtre, en 1958, l’affiche, le visuel du programme et les décors de Brouhaha, une comédie en deux actes de George Tabori. Interprétée par Peter Sellers qui joue le rôle du Sultan de Huwayat, un ancien protectorat anglais « près de la mer », la pièce fut présentée aussi au Théâtre royal de Brighton en juillet et août 1958. Elle sera retransmise, en direct, à la télévision, par la BBC, le 18 septembre de la même année puis sera rejouée en 1961 à Paris, au Théâtre de la Renaissance, avec une mise en scène de Jacques Fabbri, mais, cette fois, les décors et costumes ne seront plus d’André François, mais de Yves Faucheur.
Directeur et auteur de théâtre, scénariste, acteur et réalisateur, George Tabori fut, comme André François, un remarquable citoyen du monde : né à Budapest le 24 mai 1914 dans une famille lettrée d’origine juive et donc austro-hongrois de naissance, il part à Berlin d’où il est chassé en 1933 par la montée du nazisme. Il s’établit alors à Londres où il opte, en 1941, pour la nationalité britannique et combat, durant la seconde guerre mondiale, sous le drapeau anglais. Puis ce sera Jérusalem, Hollywood et New York où il écrit des romans et des scenarii pour Alfred Hitchcock, Anatole Litvak ou Joseph Losey, assiste Charles Laughton et se lie à Charlie Chaplin, Greta Garbo et Bertold Brecht. Revenu en Europe en 1969, il compose, pour le théâtre, des comédies funestes où il se rit amèrement des drames causés par Hitler comme la déportation de sa mère ou la mort de son père à Auschwitz. Éclectique, il adapte Euripide, Shakespeare, Kafka, Brecht, Beckett… Puis ce sera Vienne où il dirige le Schauspielhaus et enfin Berlin où il meurt le 23 juillet 2007.
Un riche parcours géographique et humain proche de celui d’André François qui parlait le hongrois de sa famille, le roumain de sa ville natale, l’allemand de l’occupant autrichien, l’anglais de son épouse et le français de sa patrie d’adoption. Né en Roumanie, André François vint en France, travailla en Grande Bretagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, États-Unis, Japon…. D’autre part, George Tabori avait un sens suraigu de la dérision et une personnalité sensible et complexe pour laquelle André François ne put qu’éprouver une forte empathie. Et ils sont tous deux des talents rares venus de l’Est, offerts en cadeau à l’Occident.
… Robert Desnos et les autres…
En France, signalons encore l’affiche des Dernières singeries du dramaturge Jean Bois (Théâtre de la Gaîté Montparnasse, 1971) et celle de Les Assiettes de Pierre Byland et Philippe Gaulier (Petit Odéon, 1974), sujets très inspirants pour lui par leur anticonformisme parfois grinçant. Ces placards sont désormais plus connus et célébrés que l’œuvre qu’ils devaient magnifier.
Pour le spectacle de Eve Griliquez, Vous avez le bonjour de Robert Desnos, présentant des poésies, sketches et chansons de Desnos et dont la première eut lieu au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse le 26 février 1972, il fit l’affiche, mais aussi la scénographie et les costumes. Plusieurs musiciens y furent associés parmi lesquels Michel Legrand, Joseph et Wladimir Kosma. Là encore, on ne connaît la participation d’André François que par le livre publié par Herscher, décidément très précieux, qui en présente trois planches, intrigantes, oniriques et surréalistes, donnant une furieuse envie de connaître les autres, hélas ! cramées elles aussi.
Que faire, sinon déplorer que quasiment tous les originaux, documents et archives de ces si fructueuses collaborations soient partis en fumée ?
Postérité adventice : durant l’été 2018, en Avignon, une petite compagnie théâtrale, Le Projecteur H, a accommodé, pour la scène, la fameuse Lettre des îles Baladar, album goguenard, anticolonialiste et iconoclaste, dû aux génies conjoints de Jacques Prévert et André François (Le Point du Jour, 1952). Ce spectacle, itinérant, fut invité au Centre André François le 5 juin 2018.
Qu’eussent pensé, de cette tardive adaptation, les deux compères réunis au paradis de la pasquinade ? Nemo scit !
La vie continue… In saecula saeculorum…
Avec Terpsichore, la danse
La danse de salon a suggéré à André François les joyeuses moqueries de quelques dessins d’humour parus essentiellement dans la presse satirique, Liliput en particulier, que l’on retrouve dans divers recueils de dessins de presse, comme Double Bedside Book, The Tattooed Sailor, Mit Gestraûbten Federn ou The Half Naked Knight. Les couples mondains, souvent vieillissants, sont tournés en ridicule, mais sans la méchanceté acerbe d’un Tomi Ungerer dans The Party. Une thématique certes marginale dans son inspiration, mais qui nous vaut quelques images bon enfant suscitant une bienfaisante hilarité.
Certaines publicités, aussi, s’inspirent parfois des chorégraphies, ainsi celle de Dutch Masters où deux garçons de café portent leurs plateaux en dansant.
Mais c’est par son intérêt pour le ballet qu’il honore Terpsichore et a été amené à collaborer brillamment avec quelques grands compositeurs (Georges Auric, Michel Legrand, Georges Gerschwin, John Dankworth…) et chorégraphes (Roland Petit, Gene Kelly, Peter Darrell…) de la scène du XXème siècle.
Odette Joyeux…
André François a imaginé et réalisé les décors et costumes d’un ballet, Galatée, pour un feuilleton télévisé à grand succès, composé de huit épisodes de 26 minutes par Philippe Agostini.
L’âge heureux, petite intrigue policière, en noir et blanc, diffusée par la première chaîne de l’ORTF à partir du 12 février 1966, fut créée par Odette Joyeux d’après le roman Côté Jardin, mémoires d’un rat qu’elle écrivit en 1951. Elle y joue un rôle de premier plan aux côtés de Pierre Mondy, Françoise Rosay, Louis Velle, et Danièle Lebrun, tandis que les rôles de danseurs sont tenus par de séduisantes étoiles de l’époque, Christiane Vlassi et Jean-Pierre Bonnefous. La petite Delphine Desyeux (12 ans), qui joue Galatée, y manifeste des dons pleins de promesses.
Le ballet inclus avait tout pour plaire à André François, par sa fantaisie et son allusion mythologique : le costume qu’il a dessiné pour les fillettes est délicieux. En outre, la série, que l’on peut voir en DVD, fut tournée dans les locaux fermés au public et sur les fascinants toits nocturnes du Palais Garnier : André François a beaucoup fréquenté, aimé et représenté cet auguste bâtiment dans ses œuvres. Son nom est crédité en grandes majuscules dans le générique du film de 1966 mais… ne figure pas sur l’emballage des DVD qui datent de 2003. Un malencontreux oubli caractéristique d’une époque qui glisse inexorablement dans l’ignorance et l’oubli…
La partition de Georges Auric, alors administrateur de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, est très présente dans les répétitions au piano et les représentations sur scène, et, lancinante, elle dramatise aussi l’ensemble de la narration. Une superbe réussite musicale qui rappelle la contribution de ce compositeur à de nombreux films de légende, comme Le Sang d’un poète ou La Belle et la Bête de Jean Cocteau.
Tout cela a désormais un charme quelque peu désuet mais c’est un document fort intéressant sur les coulisses d’un théâtre lyrique, la vie d’un corps de ballet et la discipline imposée aux petits rats, que Delphine Desyeux qui, comme Odette Joyeux, l’a bien connue, qualifie de « terrifiante ».
… Roland Petit…
Roland Petit, danseur et chorégraphe polyvalent dans ses exigences, a toujours donné une grande importance aux décors et costumes de ses ballets. De même que Merce Cunningham s’est offert les services de Robert Rauschenberg ou Andy Warhol, Roland Petit a travaillé avec de nombreux glorieux artistes comme Jean Carzou, César, Jean Cocteau, Max Ernst, Bernard Quentin, Martial Raysse, Yves Saint Laurent, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely… et notre André François, qui est là en épatante compagnie.
Durant la saison 1956-1957, c’est de lui que Roland Petit sollicite la collaboration, pour la Revue des Ballets de Paris, au Théâtre de Paris que dirigeaient alors Elvire Popesco et Hubert de Malet. André créa alors une élégante affiche et la couverture du somptueux programme, tous deux lithographiés. Il conçut les décors et costumes de Valentine ou Le Vélo magique, une féerie en dix tableaux chorégraphiée par Roland Petit en personne sur un livret de Jean-Pierre Grédy. Le générique de ce ballet est on ne peut plus prestigieux : la musique est de Michel Legrand et les lyrics de Raymond Queneau qu’André François retrouvera en 1979 quand il illustrera, avec une violence douloureuse, Si tu t’imagines aux éditions Rombaldi (Bibliothèque des Chefs-d’œuvre). Les danseurs vedettes sont évidemment Roland Petit lui-même, et sa très chère Zizi Jeanmaire. Les projets de décors, que l’on ne connaît malheureusement que par les copies de Herscher, sont éblouissants d’inventivité.
La photothèque Getty Images de Mark Getty conserve de très belles photos de cette exaltante aventure. On rêve que cette féerie reprenne vie, un jour, sur une scène contemporaine…
… Gene Kelly
C’est la grâce qui est survenue à Pas de Dieux, une fantaisie mythologique allègrement chorégraphée par Gene Kelly, en 1960, à L’Opéra de Paris alors dirigé par A-M Julien. Son titre, en forme de ces jeux de mots qu’aimait André François, est irrévérencieusement polysémique. Claude Bessy, qui fut danseuse étoile et joua le rôle d’Aphrodite dans ce ballet représenté pour la première fois le 6 juillet 1960, a convaincu Eric Vu-An, directeur artistique de l’Opéra Nice-Méditerranée, de remonter ce spectacle qui n’avait été repris que deux fois à l’Opéra de Paris, le 7 octobre 1975 et le 30 mars 2004. Il est flatteur de constater que, pour chacune des reprises de Pas de Dieux, les décors et costumes, débordants d’humour et de joie de vivre, imaginés par André François, ont été conservés. Avec émotion et fierté, Claude Bessy a redirigé, en 2011 et en 2014, l’allègre et si dynamique chorégraphie de Gene Kelly qui eut un tel succès qu’elle lui valut d’être promu Chevalier de la Légion d’Honneur. Les danseurs se déhanchent sur la musique inventive et exubérante du concerto en fa pour piano et orchestre (1925) de Georges Gershwin interprété par le pianiste Michel Quéval. On entendait déjà le finale de ce concerto dans Un américain à Paris. Cette géniale comédie de Vincente Minelli (1951) avait intégré de longs extraits de Gerschwin dans la bande musicale du film, chorégraphié par Gene Kelly et dansé avec Leslie Caron. Elle présente bien des parentés avec notre Pas de Dieux où les amusants et poétiques décors de plage ou de bar sont fortement influencés par ceux de diverses comédies musicales américaines et les malicieuses figures chorégraphiques, très caractéristiques du style « Gene Kelly », allient le rythme jazzy à l’humour sans, toutefois, renier académisme et classicisme.
Le sublime rideau de scène qu’André a peint est un chef d’œuvre : Pégase, grand inspirateur des poètes, piaffe fièrement devant l’Opéra dans les lumières enchanteresses du Paris nocturne. La vision fantasmée de notre capitale par Aphrodite et Éros depuis l’Olympe est un ravissement teinté de drôlerie. La mythologie grecque vue depuis Hollywood est quelque peu fantaisiste et semble confondre Arès et Zeus, mais ces approximations malicieuses ajoutent au plaisir.
J’ai fait deux fois le voyage de Nice avec mes petites filles, en 2011 et 2014, pour assister à cette merveille que France 3 a diffusée depuis à diverses reprises. Pierre Farkas, fils d’André François, a assisté à la première en famille. Depuis, en 2016, un DVD a été produit.
Pour mon exposition André François L’Imagination graphique à l’École Estienne en janvier 2018, Camille Scalabre, professeur dans cet établissement, a adroitement copié sur toile le magnifique rideau de scène : il ouvrait noblement le parcours de l’exposition.
On se souvient que Gene Kelly a joué, chanté et dansé dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy et on peut se demander si le souvenir des costumes vivement colorés d’André François n’a pas inspiré ceux de ce film. La musique du film était de Michel Legrand qui avait d’ores et déjà travaillé avec André François à deux reprises.
D’importants documents sur ce ballet sont conservés dans les archives de l’Opéra de Paris.
Le programme de Pas de Dieux, en 1960, était luxueux, et il comportait de grandes photos des répétitions et représentations. Il renfermait une superbe reproduction du rideau de scène tirée à part sur une confortable double page. O tempora ! O mores ! Ceux de 2011 et de 2014 sont plus… fonctionnels. Celui de 2011 renferme une passionnante rubrique où Jean-Pierre Laporte, qui en assurait la supervision technique et artistique, explicite la réalisation des décors et costumes d’après les documents conservés à l’Opéra de Paris et les objets de la collection privée de Claude Bessy. Ainsi prêta-t-elle le précieux tutu qu’elle portait lors de la création du ballet. « Vous y veillerez comme à la prunelle de vos yeux », avait-elle recommandé.
Le programme de 2014 est hélas ! fort discret sur le rôle d’André François.
Comme les DVD de L’Âge heureux…
Sic transit gloria.
Nonobstant, le ballet Pas de Dieux a été redonné à l’Opéra de Nice-Côte d’Azur fin décembre 2019. J’eusse aimé m’y précipiter, mais, hélas ! les grèves ont brisé mon élan. Mais on m’a offert le programme et, alleluia ! André François y retrouve la place qu’il mérite : nihil enim perdidit…
… et Peter Darrell
Dans la chronologie annexée au catalogue André François Affiches et Graphisme de la Bibliothèque Forney, sont mentionnés, pour l’année 1964, les décors et costumes de Street Games au Western Theatre Ballet, sous la direction de Peter Darrell (1929-1987), le si imaginatif danseur et chorégraphe anglais. Soucieux d’enrichir le ballet classique de thèmes contemporains, il avait fondé à Bristol, avec sa complice Elizabeth West qui enseignait, dans cette ville, à la Old Vic School, le Western Theatre Ballet qui, en 1969, déménagera à Glasgow où il deviendra le très fameux Scottish Ballet. Sur les programmes, curieusement non datés, illustrés de très belles photos en noir et blanc, André François est présenté comme « designer ». Les photos de Street Games (Children at play in the back streets) sont signées par John Van Lund.
La même année, le Western Theatre Ballet se produira au Festival de Bath, charmante ville balnéaire du Comté de Somerset qui inspira, en son temps, quelques scènes romanesques à Jane Austen. C’est une autre bien différente héroïne de l’histoire du féminisme qui sera célébrée au cours de ce festival d’été. En effet, emboîtant, de loin, le pas à Aristophane, en un joyeux clin d’œil aux Dionysies d’Athènes de 411 avant J.-C., sera représenté, le 4 juin 1964, le ballet Lysistrata, dont André François conçut les décors. Cette réjouissante histoire où la grève du sexe est une arme de guerre, inspira tant et tant de créateurs à travers les âges. Elle se transforme ici, malicieusement, en une ode à la liberté des femmes, de la Grèce antique aux Croisades, en passant par les Puritains, les Suffragettes jusqu’au monde contemporain et elle ose même déborder vers un hasardeux avenir de science-fiction. De quoi séduire André François, bien au-delà des sources helléniques du sujet. La chorégraphie est évidemment de Peter Darrell, la musique fut commandée à l’acteur-compositeur britannique John Dankworth, le scénario et les chansons, qui furent interprétées par l’anglaise Cleo Laine, furent composés par le pianiste américain Benny Green. La danseuse Elaine McDonald, égérie de Peter Durrell, faisait partie du casting.
Ce festival fut suivi par de nombreux journalistes, car la vedette du ballet furieusement romantique La Sylphide n’était autre que Rudolf Noureev qui évoluait avec sa partenaire fétiche Margot Fonteyn et son directeur était, excusez du peu, Yehudi Menuhin. La presse magazine diffusa une pub de BP en hommage à Menuhin, mais le graphiste qui la réalisa n’était pas notre André François mais le peintre et graveur Julian Trevelyan du Royal College of Art. L’éminent critique Clive Barnes, qui a rendu compte de ce festival, est plutôt sévère pour notre Lysistrata. Dans le numéro du 19 juin 1964 de The Spectator, seule le prestation de la chanteuse Cleo Laine « in sweetly rasping voice » et, hosanna ! les décors d’André François suscitent son admiration : « The hero of the evening was the designer, Andre Francois, whose charming bawdiness gave Lysistrata a style and grace it would never otherwise have achieved.»
Voilà qui fait quelque peu fantasmer ! Qu’on eût aimé en savoir davantage sur cette « charming bawdiness » que l’on pourrait traduire, faute de mieux, en « charmante paillardise », bien dans la manière souvent polissonne du « hero » de notre exposition…
On ose espérer que, en dépit de la malencontreuse fournaise où périrent tant d’irremplaçables archives, d’autres documents referont surface, en France ou dans sa très chère Albion, les deux pays où ce génie multiforme a travaillé sur les arts de la scène, et permettront de mieux connaître et éclairer ce pan de l’œuvre d’André François, si riche et trop longtemps laissé dans l’ombre.
Sursum corda !
Janine Kotwica
Juin 2020
Une exposition qui a eu lieu à Centre André Frabçois
du 29/09/2020 au 28/11/2020